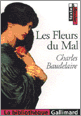Explorer le catalogue Gallimard Jeunesse par thèmes
- Animaux
- -
- Antiquité
- -
- Aventure
- -
- Conte
- -
- Environnement
- -
- Fable
- -
- Jeu de mots
- -
- Merveilleux
- -
- Moyen Âge
- -
- Roman policier
Dossiers thématiques

Le procès
« On est toujours un peu fautif » Albert Camus
Mêlant intérêts dramatique, psychologique et philosophique, les récits de procès apparaissent bien souvent dans les œuvres littéraires ou cinématographiques comme un passage crucial, préparé et conduit de manière à frapper l’imagination du lecteur. Les notions de crime, de culpabilité, d’innocence et de châtiment ont depuis les textes fondateurs constitué de puissants moteurs de la narration et du théâtre. Cette position intermédiaire entre le récit vivant et le débat d’idées permet aussi souvent de faire du procès littéraire, du fait de sa position en abyme, un moyen pour l’écrivain de porter un jugement sur des problèmes moraux ou sociaux de son temps. C’est à partir de quelques œuvres représentatives, aussi bien classiques que contemporaines, que nous interrogerons ces variations autour du procès.
Dossier initialement publié dans le numéro 32 des Mots du Cercle, mai-juin-juillet 2007.
- Dossier
- Bibliographie
« Ce regard lui apprit qu’il était devant la justice, figure aux sombres façons. » (Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, chapitre 7, « L’interrogatoire »)
Objet littéraire à part entière, le procès apparaît cependant à première vue comme un projet paradoxal : quel intérêt peut-il y avoir à « raconter un procès » ? En effet, ne se cantonne-t-il pas à un lieu clos (qui limite l’action), accessible au public (donc qui n’a rien pour susciter particulièrement la curiosité), où se déroule un rituel immuable (chacun est à sa place et joue son rôle) largement commandé par un livre dont la spécificité et l’immuabilité (les articles de loi) ? Pourtant les récits de procès laissent voir, par leur dramaturgie, leurs personnages et les errements qu’ils éclairent une face fascinante de la condition humaine.
« Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J’ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. » (Stendhal, Le rouge et le noir, Stendhal, chapitre XLI, « Le jugement »)
C’est en effet d’abord la personnalité de l’accusé qui semble romanesque. Bien souvent l’attention du public et du lecteur se focalise sur lui, tant il paraît à la fois inquiétant (il a commis un crime) et inoffensif (il est entre les mains de la justice). L’accusé apparaît dans une ambiguë posture tragique, tout à la fois omnipotent, puisqu’il a renversé les lois humaines (Mériam Korichi en fait l’image même de l’insoumission), et soumis. La dramaturgie du procès lui ménage un rôle de choix : de manière significative, c’est à lui qu’appartiennent les derniers mots du procès avant la délibération, et les écrivains savent toujours tirer profit de cet ultime adieu. Mary Shelley saura créer dans Frankenstein un effet particulièrement efficace de cette posture de l’accusé en déplaçant le procès de Victor : c’est Justine, la servante dévouée, qui est accusée à tort des crimes de la créature maudite, se substituant dramatiquement aux deux coupables réels : Frankenstein et son monstre. La jeune fille ne pourra être innocentée par Victor car ce dernier se résout à avouer qu’il est le créateur du vrai coupable. Le procès de l’innocent est également le procédé employé par Dumas pour amorcer la vengeance de Monte-Cristo. La place du procès dans l’œuvre est alors déplacée : elle n’est plus sa conclusion mais son point de départ.
« Je vous demande la tête de cet homme, a-t-il dit, et c’est le cœur léger que je vous la demande. » (Camus, L’Étranger, deuxième partie, chapitre 4)
L’accusé, s’il occupe la première place dans le déroulement du procès, n’est pas seul. Malgré le sentiment d’abandon et de solitude qui caractérise le Meursault de L’Étranger percevant son procès derrière un voile de distance, la culpabilité intérieure de l’accusé se dédouble en s’incarnant. Face à lui s’affrontent en effet des personnages à qui la codification du procès attribue une position définie selon un protocole établi. Chaque auteur fera alors du procureur, de l’avocat et du président des caractères hauts en couleur, se démarquant de leur rôle ou s’y identifiant totalement. Ainsi de Me Abad, personnalité charismatique de L’Adversaire, qui décide de défendre l’indéfendable parricide et infanticide en mémoire des enfants de Jean-Claude Romand, devenant ainsi une figure idéalisée de l’avocat.
« DANDIN. – Allons nous délasser à voir d’autres procès. » (Racine, Les Plaideurs, Acte III, scène 4)
Pour décider du juste et de l’injuste, pour élucider et châtier, pour devenir le théâtre de la vérité, le procès doit d’abord se faire luimême récit. Le procès expose devant le public un enchaînement de faits et d’actes, obligeant l’accusé à reformuler, parfois, après les enquêteurs et le juge d’instruction, pour la troisième fois, les faits qui lui sont reprochés. L’évocation publique de son crime, guidée par les questions du juge, en fait une narration qui, tout en figeant solennellement ses actes aux yeux de tous, établit la réalité du crime. Cet humiliant aveu est alors un premier châtiment, l’acte inaugural de l’expiation. Mais si le récit sincère est, juste avant le verdict, la visée du procès, force est de constater que tout comme son narrateur, ce récit est à chaque fois différent. À l’origine du procès, il y a toujours crime, il y a surtout l’immense diversité des crimes et des situations. Si la loi prévoit les délits à punir, chaque procès juge un délit particulier, original, unique. En cela un procès est un réservoir d’histoires, d’idées, de scénarios qui brillent tous par leur réalisme et leur plus ou moins grand degré de violence. On peut rappeler ici que Stendhal s’inspira pour Le Rouge et le Noir de l’affaire du séminariste criminel Antoine Berthet et citer Dumas : « Pour les personnes nerveuses qui cherchent les émotions, il n’y a pas de spectacle qui vaille celui-là.» Et la dimension universelle du crime, qui, via les anonymes convoqués au tribunal peut nous concerner tous, renforce encore la puissance évocatrice du procès : on s’y voit en miroir, et la métaphore du double traverse par exemple une œuvre comme L’Adversaire, dont le titre rappelle bien que l’accusé c’est la figure absolue de l’Autre, mais c’est aussi un alter ego.
« CRÉON. – Le malheureux, qui fait le procès de son père ! » (Sophocle, Antigone)
Tout procès contient enfin l’amorce d’une réflexion morale sur la justice elle-même, de son idéalisation à sa pratique. La justice romanesque est bien souvent un déni de justice, où le juge est corrompu, partial et soumis à des impératifs de classe : que l’on songe par exemple aux procès expéditifs d’Edmond Dantès ou de Julien Sorel. Le héros, pour atteindre à la grandeur qui fonde son héroïsme, conserve une part d’innocence méconnue et maltraitée : il saura ainsi attirer la compassion – c’est aussi le cas de l’Hippolyte du Phèdre de Racine – ou déclencher la réparation. Le Joseph K. du Procès de Kafka, quant à lui, erre dans les méandres d’une culpabilité qui se rapproche d’un procès sans jamais véritablement y aboutir, sans que la sentence soit jamais motivée. Kafka écrit : « Avoir un pareil procès c’est l’avoir déjà perdu. » La loi apparaît alors comme la manifestation même de l’arbitraire. Et au fond, si Camus peut écrire que « nos plus grands moralistes ne sont pas des faiseurs de maximes, mais des romanciers », c’est bien que chaque roman du procès laisse entrevoir en creux un idéal de justice.
« PHÈDRE. – Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. » (Racine, Phèdre, Acte V, scène 7)
Si le récit de procès est présent dans un grand nombre de romans, c’est peut-être au théâtre que l’on retrouve sous une forme métaphorique le plus couramment une situation de procès. Le dispositif du procès est en lui-même théâtral : costumes identifiant des fonctions, cérémonial, espace clos, structure fixe du déroulement, nécessité de l’oralité des échanges et donc apparence de spontanéité, présence d’un public muet mais indispensable. Son architecture elle-même implique le spectacle : si étymologiquement le théâtre est un lieu où l’on voit, une salle de procès est indéniablement théâtrale. Par symétrie, le théâtre se rapproche souvent du tribunal.
« DANDIN. – Je ne veux point être un juge en peinture. » (Racine, Les Plaideurs, Acte II, scène 13)
Il en va ainsi dans la comédie où le simulacre de procès est un des lieux communs de la farce. On y tourne tout d’abord en dérision un langage et des pratiques codifiées et connues du grand public en les vidant de leur sens et en amplifiant leur caractère mécanique. Le procès est aussi l’endroit privilégié de l’exercice public de l’autorité, où les personnages incarnant la justice se prêtent idéalement à cette impertinence qui est le moteur du rire. De la dérision médiévale de La Farce de Maître Pathelin à la comédie de Racine, Les Plaideurs, jusqu’aux parodies kafkaïennes, les procédés sont récurrents : c’est l’objet de la justice qui est dérisoire (le procès d’un chien chez Racine), ce sont les officiers de justice, parfaits pour tout renversement carnavalesque, qui sont ignorants, bornés, vénaux et brutaux, ce sont les justiciables qui sont les vecteurs de la ruse et de la tromperie. Désordre, corruption, lubricité sont les traits traditionnels de cette satire de la justice.
« Phèdre n’est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. » (Racine, préface de Phèdre)
Mais la forme du procès triomphe également dans la tragédie : elle fait de l’ensemble des protagonistes des plaideurs en puissance, les paroles proférées accusent ou défendent. Le champ lexical de la justice est omniprésent et les duels un des motifs clés de la dramaturgie tragique. Puisque la tragédie se tend nécessairement de l’hybris (la démesure), à l’amartia (la faute, crime ou aveu) jusqu’au châtiment (la mort, l’exil), que le héros tragique se définit comme un « innocent coupable », toute tragédie suppose une confrontation avec la loi. Que l’on prenne l’exemple de Phèdre, où l’absence et la mort supposée de Thésée, incarnation de la loi, entraînent la transgression. La dimension édificatrice, moralisatrice, civique de la tragédie – mais aussi de la comédie – fait enfin se rejoindre ces deux formes que sont le procès et le théâtre : le procès n’est-il pas à la fois le lieu de la terreur et celui de la pitié ? N’est-il pas aussi une mise en garde, le rappel d’une culpabilité diffuse qui sert aussi bien de ciment social que de police des liens humains ?
« On est toujours un peu fautif. » (Camus, L’Étranger)
Mais la figure du procès et le débat qui s’y engage n’est pas seulement à observer à l’intérieur des œuvres littéraires. On pourrait également interroger sous l’aspect du procès des œuvres, aujourd’hui classiques, qui sont passées elles-mêmes devant les tribunaux. Ainsi, au XIXe siècle, les procès de Flaubert et de Baudelaire sont symptomatiques des accusations faites à la littérature, où l’on établit le caractère immoral, « fautif » d’un texte littéraire. De la même manière, les pièces de Molière provoquaient scandale et censure à la hauteur de leur portée contestatrice. Le procès que rapporte La Critique de l’école des femmes est à ce titre instructif : les reproches de forme (Molière mêle le registre de la farce et celui de la grande comédie) rejoignent ceux faits au contenu de la pièce (la remise en cause raisonnée de l’autorité paternelle et maritale, l’apologie de l’émancipation morale et intellectuelle des jeunes filles). Cet aspect permet de soulever la question du goût et des normes de chaque époque, et la façon dont l’histoire littéraire et l’école jouent d’une certaine manière le rôle des procureurs de la littérature.
« Sa peccadille fut jugée un cas pendable. » (La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste »)
De la même manière, la notion de littérature engagée, au-delà d’une réflexion sur la justice et l’injustice, fait de l’écrivain un avocat dans la société, avocat dont le livre adopte la forme et la fonction d’un plaidoyer. Quelles sont alors les causes à défendre, comment en tant qu’artiste le romancier, le pamphlétaire légitime-t-il sa parole en dehors du cadre du tribunal ? Comment se sert-il de sa notoriété, d’où tire-t-il son savoir ? Le J’accuse de Zola, faisant de la presse une « tribune-tribunal », est à ce titre évocateur : combien d’écrivains font aujourd’hui des médias une cour où s’instruisent ouvertement une nouvelle espèce de procès ? La question revient au fond, à s’intéresser au lien entre le procès et le public : la justice est rendue symboliquement au nom des citoyens, aux yeux des citoyens. Le romancier engagé « amène » de ce fait le tribunal hors les murs pour faire du monde la salle d’audience de sa pensée. De la même manière qu’un Chaplin faisait à la fin du doux-amer Monsieur Verdoux, inspiré de l’affaire Landru, le procès d’une société moderne qui conduit de la ruine au crime.