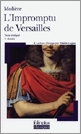Explorer le catalogue Gallimard Jeunesse par thèmes
- Animaux
- -
- Antiquité
- -
- Aventure
- -
- Conte
- -
- Environnement
- -
- Fable
- -
- Jeu de mots
- -
- Merveilleux
- -
- Moyen Âge
- -
- Roman policier
Dossiers thématiques

Le travail
« Je travaille. À quoi ? Mais... À tout ! » Victor Hugo
Étymologiquement, le travail renvoie au trepalium, un instrument de torture. Y étaient liées les notions de peine, de désagrément, de fatigue. À la fin du Moyen-Âge on l’associe à l’effort lié à l’activité professionnelle et enfin à cette activité elle-même. Il va sans dire que cette histoire lexicale du travail place cette notion du côté d’une douleur. On ne travaille que contre son gré.
À ce titre, si travailler c’est souffrir sans choisir, le travail porterait en lui la vertu dramatique et littérairement intéressante de toute action qui conduit au malheur. Sans compter que le travail imposé à l’homme recèle aussi quelque chose de tragique : une force qui me dépasse m’oblige à travailler. Jusqu’à une forme d’aliénation : je deviens un objet, je ne suis plus moi-même. Et au fond, qui suis-je lorsque je travaille ? Mais le travail c’est aussi le trivial, le quotidien, l’exact opposé de l’idéal. La relation d’un écrivain au travail est de ce fait ambiguë : n’altère-t-il pas son art en évoquant le triste réel ? Lui-même, l’artiste, ne doit-il pas se tenir à distance du « vrai » travail ? Si par le travail on produit quelque chose, l’écrivain, l’artiste peuvent-ils être ainsi du côté de l’utile, de l’efficace ? Enfin le travail et ses métamorphoses (de la société rurale dont rendent compte de nombreuses fictions du travail à la société industrielle) sont une donnée fondamentale de la structure de la société : écrire sur le monde du travail suppose un regard spécifique, valorisant ou critique, sur ce monde et la société qui le produit, jusqu’aux polémiques sur le droit à la paresse. Et si aujourd’hui du cinéma au roman contemporain les fictions au travail abondent, n’est-ce pas aussi le signe d’une évolution du public des romans qui peut s’identifier à leurs personnages de travailleurs.
Dossier initialement publié dans le numéro 28 des Mots du Cercle, avril-mai-juin 2006.
- Dossier
- Bibliographie
« Jours de travail ! seuls jours où j’ai vécu ! / Ô trois fois chère solitude ! » (Musset, La nuit d’octobre)
À première vue, le travail au sens propre semble exclu du romanesque, du théâtre ou de la poésie. Les héros ne sont pas des travailleurs et il semble même que l’héroïsme, le temps consacré à la résolution des conflits qui déterminent le caractère du héros, ne laissent pas de temps à une activité salariée. On doit à ce titre se poser la question du « travail » d’un roi, d’un prince, d’une fée. Et si les activités salariées apparaissent dans les contes (un savetier, un meunier), elles n’ont semble-t-il qu’une fonction informative, puisque le héros n’est jamais raconté pratiquant cette activité. L’activité héroïque est certes récompensée, mais la régularité et la contrainte du travail en sont parfaitement absentes. Le héros a donc par rapport à la société dont il se distingue par son rang ou ses faits et gestes une forme de marginalité anoblissante, une forme d’oisiveté qui détermine sa condition héroïque et sa différence d’avec le non-héros. Précisément, quiconque se (sou)met au travail ne peut être un personnage principal de fiction.
« Mais songeons à répéter, s’il vous plaît. » (Molière, L’Impromptu de Versailles)
Il convient néanmoins de signaler les cas de fictions spécifiques qui représentent par nature le héros au travail : le roman de détectives par e xemple. C’est ici précisément l’activité professionnelle du personnage principal que l’on voit en exercice qui fait le sel du roman.
Mais, au même titre que les explorateurs, les inventeurs et les découvreurs, les chasseurs de trésors et autres chercheurs d’or, ces activités épousent à ce point l’acte de lecture, du mystère à son élucidation que l’on peut se demander dans quelle mesure le détective n’est pas une sorte d’hyper-lecteur, dédoublant le processus même de la lecture. Le travail du héros peut aussi avoir trait à l’activité artistique: les œuvres qui mettent en abyme la création littéraire sont elles aussi une exception dans la représentation d’un homme de métier. Il en va ainsi des comédiens, dans les nombreuses comédies du théâtre : de L’Illusion comique de Corneille, à l’Impromptu de Versailles de Molière, ou au Roman comique de Scarron.
« Lisez et ne rêvez pas. Plongez-vous dans de longues études ; il n’y a de continuellement bon que l’habitude d’un travail entêté. Il s’en dégage un opium qui engourdit l’âme. » (Flaubert, Correspondance)
Le travail n’est cependant pas absent de la fiction, loin s’en faut. Si les h é ros sont bien souvent associés à une activité, à un métier, la représentation systématique de leur activité professionnelle devient un des aspects importants du réalisme. On pourrait même dire que le t r a vail, parce que jusque-là inouï dans le roman, devient avec l’argent la marque du roman réaliste. C’est d’ailleurs dans l’activité anthropologique et sociologique des Maupassant, Flaubert, Zola ou Balzac un des critères de classement et d’organisation de leur regard sur la société. Les hommes romanesques du XIXe entreprennent une étude exhaustive du monde social et se servent des métiers, des secteurs d’activité comme principe organisateur de leur système. Le lieu de t r a vail devient alors le décor du roman, les notations sont précises, l’effet de réel se nourrit de détails, les écrivains se font glaneurs. Le vocabulaire technique des romans fonde une langue nouvelle.
« Travailler avec peine et travailler sans fruit, / Le dirai-je, mortels, qu’est-ce que cette vie ? / C’est un songe qui dure un peu plus qu’une nuit. » (Des Barreaux, La vie est un songe)
Le travail, la relation de l’individu à son activité salariée est alors au fondement même du romanesque : les romans de Zola dépeignent ainsi souvent la diversité des relations complexes qui lient un individu à son travail, de la tension entre la dignité que confère le travail et les souffrances qu’il impose, à la dégradation qui découle de sa perte toujours menaçante. Ces nuances se retro u vent dans un roman comme l’Assommoir, son travailleur exemplaire Goujet, ses « déchéants » Gervaise et Coupeau et son parasite Lantier. Où le p a rcours du personnage est en lien direct avec son activité. Ce roman, par la synthèse des parcours professionnels croisés qu’il offre, est aussi la peinture documentée et en un sens complète d’un milieu social, le microcosme ouvrier urbain.
« Un homme magnifique au travail, ce gaillard-là ! » (Zola, L’Assommoir)
Mais même les romans qui tirent ainsi profit du sujet au travail ne représentent le travailleur en activité qu’en de rares moments. Se s gestes, ses mots, ses outils, son atelier, bref les marques et les mots du travail sont amplifiés jusqu’au mythe ou dramatisés par leur mise en scène. La fiction du travail ruse avec son objet, si bien qu’on peut s’interroger sur la plasticité ou la littérarité de l’homo faber. Est-ce e n c o re un acte littéraire de décrire l’homme au travail ? Le geste du travailleur n’est-il pas en lui-même non littéraire ? Que veut-on signifier en faisant entrer ce geste dans l’espace littéraire ? Quel idiome adapté trouve-t-on ? Et quel travailleur choisit-on alors ?
« Automatiques et minutieux, / Des ouvriers silencieux / Règlent le mouvement / D’universel tictacquement / Qui fermente de fièvre et de folie / Et déchiquette, avec ses dents d’entêtement, / La parole humaine abolie. » (Verhaeren, Les usines)
Au fond, le travailleur, ou plutôt l’image que les textes en renvoient se fait généralement questionnement de la société. Le changement de point de vue permet au lecteur d’embrasser du regard le monde d’un employé, d’un artisan, d’un domestique. On lit alors aussi bien des éloges du travail, du peuple laborieux, de l’individu à son métier, des «Ouvriers charmants » rimbaldiens, l’activité sociale apparaissant comme porteuse d’une valeur en soi. L’artisan, porteur d’un savoir faire, incarne la tradition, le sacrifice du travailleur implique abnégation, souci de l’autre. Le travailleur figure un héros de la modernité, à l’image du Gilliat des Travailleurs de la mer de Victor Hugo.
« Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, / Ils travaillent. » (Hugo, Melancholia)
Mais le blâme du monde salarié et de sa médiocrité n’est pas absente des satires contemporaines. Pensons par exemple au Passe-muraille de Marcel Aymé ou à Belle du Seigneur d’Albert Cohen, l’évocation comique de la vie de bureau du paresseux Adrien Deume à la SDN, dépeignant avec dérision les mœurs bureaucratiques de ses contemporains de secteur tertiaire, ou au Playtime de Jacques Tati, poussant à l’absurde et à la poésie géométrique l’anonymat du travail de masse. Comme si le travail aujourd’hui, détaché de sa dimension mythique, n’était plus capable de contenir l’héroïsme. Le blâme du travail prend une forme particulière lorsqu’il s’agit de condamner sa violence. L’ exemple le plus frappant est bien sûr les violents réquisitoires contre le travail des enfants, représenté chez bon nombre d’auteurs du XIXe siècle en particulier chez Hugo.
« Jamais nous ne travaillerons, ô flots de feux ! » (Rimbaud, Qu’est-ce pour nous, mon coeur...)
Peut-on voir un lien dans cette attaque contre le travail, jugé dangereux, aliénant ou vain, et l’image que de nombreux artistes donnèrent et donnent d’eux-mêmes ? L’artiste se définit bien souvent comme un « sans-travail ». « L’ artiste de la faim », le « saltimbanque » ou le «poète maudit » sont des marginaux, et revendiquent précisément cette exclusion sociale comme la source de leur inspiration. Le travail est honni, il est bien souvent perçu comme une déchéance, une nécessité du monde, éloignant de la poésie, altérant le talent.
« J’entends / Bruire en moi le gouffre obscur des mots flottants ; / Je travaille. » (Hugo, Je travaille)
Reste cependant que l’artiste en général et l’ écrivain en particulier peuvent aussi caractériser leur activité comme un travail à part entière, Flaubert étant un des auteurs ayant le plus évoqué cette dimension de la création romanesque : « J’aime mon travail d’un amour frénétique et perverti » écrit-il dans sa correspondance.
L’écrivain est un travailleur parce que son activité salariée est son moyen de subsistance. Elle est, depuis longtemps, associée à la notion de peine, d’ effort - que l’on pense aux interminables journées de travail de Balzac par exemple, aux recherches documentaires des réalistes ou aux brouillons des écrivains -, mais aussi à une forme de légitimation et de reconnaissance. L’écrivain mué en intellectuel joue également un rôle social : il dit le monde pour le contester autant que pour l’enchanter. L’écrivain est aujourd’hui perçu comme un élément à part entière du corps social. Il suscite à ce titre l’admiration de ses contemporains, tant il a réussi à faire se correspondre - dans le meilleur des cas - son travail et ses goûts : l’écriture comme ultime réussite, comme adhésion idéale du moi social et du moi intime ? Reste que les écrivains entièrement libérés de toute contrainte économique, les écrivains vivant « de leur plume » sont les plus rares, comme le rappelle chez Balzac le journaliste épuisé Lousteau : « Vivre de sa plume est un travail auquel se refuseraient les forçats, ils préféreraient la mort. » Le double travail de l’écrivain est-il alors source de contrainte ou d’inspiration ? Un bon médecin face à ses lecteurs-patients fait-il un bon écrivain, un enseignant, empli de ses lettres, est-il forcément un écrivain en puissance ?