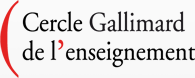Interview de Jean-Louis Backès
En quoi cette nouvelle édition renouvelle-t-elle l'étude de la pièce ? Quel(s) axe(s) d'étude avez-vous privilégié(s) ? Des jeux de scène sont-ils proposés ? Le texte grec y est-il reproduit, même par extraits ?
Il faut peut-être d’abord rappeler que la collection «Folio théâtre» s’adresse à un très large public et que sa destination première n’est pas de fournir un commentaire immédiatement utilisable dans une salle de classe. L’excellente traduction de Jean Grosjean, jusque-là accessible uniquement dans un volume de la Pléiade, est accompagnée du savant commentaire de Raphaël Dreyfus, commentaire tout à fait classique, qui avait paru dans le même volume. Il s’agit de notes érudites, destinées à faire connaître le contexte dans lequel la tragédie a été composée et, autant que faire se peut, l’interprétation qui a pu en être donnée au Ve siècle avant notre ère. Cette approche du texte n’est certes pas la seule possible, mais elle demeure absolument indispensable.
La nouvelle édition apporte une longue préface, qui pose des questions à l’interprétation, et une notice qui donne des informations sur l’histoire de la pièce, depuis Sophocle jusqu’aux représentations modernes.
La préface s’attache essentiellement à critiquer une interprétation traditionnelle depuis le début du XIXe siècle, interprétation qui se prévaut de l’autorité de Hegel : Antigone montrerait l’insoluble conflit qui oppose deux conceptions morales, deux types de lois, également respectables ; la jeune fille représenterait les lois éternelles, le roi Créon incarnerait la nécessité politique. Cette simplification excessive est contestée par une analyse détaillée de plusieurs passages importants. Il n’était pas possible, eu égard aux principes de la collection, de donner le texte grec en regard de la traduction, mais, sur la base de cette traduction, qui est beaucoup plus exacte que nombre d’autres, on peut poser des questions au vocabulaire employé par le poète. Il apparaît par exemple que l’expression « lois de la cité » ne se trouve nulle part dans le poème. On a par ailleurs consacré un développement aux problèmes posés par la traduction du mot « hybris », mot grec francisé, et qui passe, à tort, pour limpide. D’une manière générale, on a prêté la plus grande attention aux mots.
Si, dans la notice historique, il est fait allusion à de grandes mises en scène contemporaines, il n’était pas possible de procéder, faute de place, à leur analyse détaillée. Seule a été évoquée, trop rapidement, la difficile question de la musique. Les notes de Raphaël Dreyfus tentent de donner une idée de ce que pouvaient être les représentations antiques. Il n’est pas inutile de rappeler ce qu’était alors l’attitude figée des comédiens : la distance qui les séparait est à mettre en relation avec la construction du texte, qui procède si souvent par oppositions. Que se passerait-il si Antigone se roulait par terre ou se jetait dans les bras de Créon ?
Il importe sans doute de signaler que la traduction reproduite, dont il faut répéter qu’elle est d’une remarquable exactitude, est visiblement l’œuvre d’un poète et d’un vrai poète. Tous ceux qui l’ont pratiquée reconnaissent qu’elle se met très bien en bouche. C’est elle qui avait été retenue par la Comédie-Française pour la reprise de 1992. Dans un travail sur la pièce, elle permet, elle exige même qu’on la lise à haute voix.
Sophocle s'est-il inspiré d'un autre dramaturge pour écrire Antigone ?
Il n’est pas impossible que Sophocle ait inventé l’histoire d’Antigone. S’il s’est inspiré d’une œuvre antérieure, celle-ci ne nous est pas connue. Tous les exégètes sont d’accord pour admettre que la scène finale des Sept contre Thèbes d’Eschyle est un ajout tardif (cent ans après le première représentation ?), dû à un poète inconnu.
Proposez-vous une étude comparative de la pièce de Sophocle et de celles de Jean Anouilh ou de Cocteau dans cette nouvelle édition ? Comment intégrer cette intertextualité dans une séquence sur l'étude de la pièce Sophocle pour les classes de 3e ?
L’étude comparative de la pièce d’Anouilh et de la tragédie de Sophocle ne pouvait pas être menée en détail. J’ai donné, à la page 136, quelques indications qui me paraissent essentielles, mais qui ne prennent tout leur sens que par référence au reste de la notice.
La comparaison gagnerait à porter d’abord, et en détail, sur la construction narrative : quels personnages Anouilh a-t-il supprimés ou ajoutés ? La même question se pose pour les événements. Il faut aussi regarder à quel moments se produisent chez lui les interventions du chœur ; par contraste, on pourra se demander quels effets produisent, dans Sophocle, les chants du groupe choral et les interventions du coryphée. Ce travail suppose que l’on renonce à n’expliquer que des morceaux choisis. S’il est fait en détail, il fournit un riche matériau pour la réflexion.
Sur l’adaptation de Cocteau, je me suis contenté de quelques lignes, purement informatives. A mon avis, elle est très différente de celle d’Anouilh. Les deux auteurs ont parfaitement caractérisé leurs textes respectifs, en parlant l’un de « contraction », l’autre de « variation ». Cocteau a modernisé la pièce en la rapprochant, formellement, du répertoire joué de son temps. Il me semble avoir cherché une interprétation qu’il estime éternelle, et qui est plutôt vaguement hégélienne, ou vaguement romantique. Anouilh, tout en jouant lui aussi, le jeu de la comédie moderne, a radicalement transformé le climat idéologique de la tragédie ; les allusions qu’il fait, dans ses commentaires plus que dans la pièce elle-même, à l’actualité, sont loin de tout éclairer ; il faut accorder, me semble-t-il, une grande importance à la transformation du rôle du chœur, et, plus encore, au nihilisme radical qui s’exprime particulièrement dans la dernière scène, absolument originale, entre Antigone et le garde.
Antigone peut-elle être encore considérée comme une figure révolutionnaire ? Voire comme une féministe ?
Antigone est-elle féministe ? La question se posera plus facilement si l’on étudie d’abord les déclarations misogynes de Créon. Ce discours sottement brutal n’a pas disparu de nos jours, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui tentés de lire dans le texte de Sophocle l’expression de revendications ou d’affrontements qui sont apparus au grand jour il y a seulement deux cents ans. Il paraît invraisemblable qu’un personnage féminin de Sophocle réclame une égalité de statut avec les hommes.
On peut noter que, d’une manière analogue, il paraît invraisemblable que Sophocle ait songé à remettre en cause le caractère absolu de l’autorité paternelle : Hémon est indigné, mais sa révolte, toute subjective, ne peut le mener qu’au suicide.
Le suicide par protestation est aussi la voie que choisit Antigone. C’est une forme de révolte, incontestablement, et que nous pouvons comprendre, aujourd’hui. Mais des événements récents ancrent dans notre esprit l’idée que, si un homme ou une femme a le courage de s’immoler par le feu, elle ou il espère que son geste conduira les autres hommes et les autres femmes à exiger une modification de l’organisation politique et sociale. En va-t-il de même pour Antigone ?
Par ailleurs il ne faut pas oublier qu’Antigone est une princesse. Les « lois non écrites » dont elle se réclame sont le patrimoine de l’aristocratie ; la démocratie athénienne a triomphé des formes politiques antérieures en imposant l’obligation d’écrire les lois, pour que tous puissent en avoir connaissance. On ne fondera pas sur cette petite remarque une interprétation de la pièce entière. Créon ne représente en aucune manière la voix du peuple. Mais il est possible que, dans le public athénien, l’expression « lois non écrites » ait éveillé, passagèrement, un vague souvenir. Antigone passerait alors pour une nostalgique du passé plus que pour une révoltée.
Quel groupement de textes imaginer autour des « femmes en révolte » ?
Si, dans un groupement de textes, on préfère une forte homogénéité, il faut chercher des textes où les «femmes en révolte» seront plutôt des victimes que des activistes. «Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes ?» demande l’héroïne des Caprices de Marianne. Comparer à Antigone le personnage inventé par Alfred de Musset relève, sans aucun doute, d’une virtuosité herméneutique qui fait penser aux sophistes. Il faut pourtant se demander pourquoi, depuis Lysistrata, ou depuis les Femmes savantes, la question du sort des femmes est plus facilement abordée par la comédie. Tout se passe comme si cette question devait être confinée à la zone de la vie privée. Ou bien à l’inverse, on célèbre des héroïnes, mais on s’empresse de souligner leurs faiblesses. Il serait intéressant de comparer Antigone à Jeanne d’Arc. On peut penser à la tragédie de Schiller, dont malheureusement il est difficile de trouver actuellement une traduction.
Dans quelle mesure George Sand est-elle révoltée ? Et Anna Karénine ?
Si l’on intègre Antigone dans un corpus de textes réellement féministes, il faudra prendre soin de montrer au prix de quels coups de force on peut faire de la princesse un emblème.
Et comment aborder le problème de la représentation du chœur alors que celui-ci n'a plus d'équivalent aujourd'hui ?
La question du chœur est primordiale. Nous avons encore du comédien une conception quasi autiste. Il ne mêle pas sa voix à celle des autres. D’aucuns prétendent que c’est dans l’opéra qu’il faut chercher le véritable héritage de la tragédie antique.
Dans une classe, si le groupe est bien soudé, si le texte est bien rythmé, pourquoi ne pas le dire à plusieurs ? J’ai essayé, on peut. C’était, il est vrai, à la faculté, avec un groupe d’étudiants de première année, tous volontaires pour cette entreprise un peu exceptionnelle.
En quoi cette histoire familiale est-elle aussi un mythe universel ? Pourquoi nous parle-t-elle encore aujourd’hui ?
A mon avis, cette histoire familiale nous parle d’abord parce que c’est une histoire familiale, parce que l’espèce des oncles stupidement tyranniques prolifère, et pas seulement sur trône, et parce qu’il arrive, et fréquemment, que les histoires de famille mettent en jeu de graves questions de morale. Les conflits religieux n’intéressent pas seulement les archevêques et les ayatollahs.
J’avoue par ailleurs que l’expression « mythe universel » me laisse assez sceptique, autant que l’expression « invariant mythique ». Peut passer pour invariant ce dont nous n’avons pas encore remarqué les variations.
Comment expliquez-vous le regain populaire et notamment adolescent autour du théâtre tragique antique ?
Je suis ravi d’entendre dire que le public adolescent se passionne à nouveau pour le théâtre antique. Puis-je suggérer, d’abord, que le théâtre antique est beaucoup plus riche et varié qu’on ne le dit ? On limite son répertoire à cinq ou six pièces connues, alors qu’il nous en reste plus de trente, sans compter les fragments.
J’aimerais croire que la forme de l’agôn attire particulièrement les jeunes gens, lorsqu’ils découvrent le bonheur de s’opposer à l’autorité. Chez Sophocle, et les autres, la tension dans le dialogue a une force qui reste prodigieuse, et dont rend bien compte la lecture à haute voix.
Mais nous avons perdu la musique. Nous ne savons plus que le chœur dansait, que les personnages eux-mêmes prenaient part au chant : c’est ce qu’indiquent les italiques à la page 89, à la page 112 (même Créon chante). Les partitions sont perdues, sauf un tout petit fragment d’Euripide, qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout.
Quand ils en ont les moyens, certains metteurs en scène contemporains renoncent aux solutions économiques, comme, par exemple, le chœur réduit à un seul personnage, ou même à un simple enregistrement. Ariane Mnouchkine n’est pas la seule à montrer qu’on peut faire paraître sur le théâtre un chœur qui ressemble aux chœurs antiques.
Mais c’est pour une troupe d’écolières, et non pour des professionnels, que Racine a écrit Esther et surtout Athalie, où renaît la forme de la tragédie antique. Le compositeur avec qui il collaborait a naturellement fabriqué des partitions difficiles, pleines d’ornements. Les demoiselles de Saint-Cyr recevaient un enseignement musical assez poussé. Mais n’y a-t-il pas quelque chose à chercher aujourd’hui entre la psalmodie et le rap ?