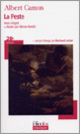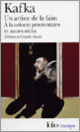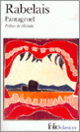Dossiers thématiques

Le médecin
« Une blessure s’est ouverte, […] Étalée comme une mine à ciel ouvert » Franz Kafka
Étudier les liens entre médecine et littérature, c’est s’intéresser aux reflets et aux traces de l’évolution d’une science dans les lettres, qui ont été comme les dépositaires, au .l des siècles, des usages des médecins. De la magie et la mythologie au positivisme, les textes et les formes littéraires se sont penchés sur les errements et les progrès de l’art de soigner, de l’art de guérir. Au-delà de cet intérêt pour les mutations de la médecine et de son efficacité, la littérature a plus spécifiquement employé des médecins, que ce soit pour les honnir, pour les aduler, ou les métamorphoser à son gré. Au vu de la diversité de ces figures de médecin, une question vient nécessairement à l’esprit : quelle place occupent les praticiens des fictions, quel rôle leur fait-on jouer ? Le médecin est-il un héros ou une victime littéraire, un modèle ou un repoussoir de l’écrivain ? Si les auteurs s’intéressent autant à eux, c’est sans doute aussi à cause de cette analogie ancienne de l’art en général, de la littérature en particulier, et de la médecine. Manière de justifier une vocation souvent jugée futile, façon de s’octroyer une mission à peu de frais ? Parler du médecin en littérature conduira enfin à évoquer les images de la maladie. De cette maladie, antichambre de la mort, que viennent apaiser et la cure et l’écrit.
Dossier initialement publié dans le numéro 22 des Mots du Cercle, novembre-décembre-janvier 2004-2005.
- Dossier
- Bibliographie
« Quand je me décidai religieusement à cette vie d’obscure résignation, j’ai longtemps hésité à me faire curé, médecin de campagne ou juge de paix. » (Balzac, Le médecin de campagne)
Les représentations du médecin se sont toujours, semble-t-il, articulées autour d’un type double et antithétique. Pour le meilleur d’abord. Dans la mytholgie grecque, le médecin, c’est Esculape, le dieu serpent, fils d’Apollon, qui libère les villes de leurs maux. Le médecin des romans réalistes modernes est lui une incarnation de l’extrême sagesse. Médecin clinicien, médecin de terrain, il figure un apôtre de la médecine expérimentale. Le docteur Rieux, le docteur Benassis soignent les plus humbles, incarnent un idéal d’humanité. « Je ne veux ni gloire ni fortune, je ne demande à mes malades ni louange ni reconnaissance » fait dire Balzac à son médecin de campagne. Ils sont cette puissance dévouée, réparatrice et réconfortante, le Bianchon du même Balzac se posant « à la fois en médecin, en confesseur et en confident ». Un héros parfait retrouvant le sacré de la médecine des premiers temps. En un sens ces personnages ont contribué à élever cette profession à la hauteur du mythe. Ce médecin-là est synonyme de modernité, de lumière, de progrès.
« Dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » (Camus, La peste)
Omniprésent dans les œuvres embrassant la société toute entière, type social inévitable, le médecin devient aussi au-delà de ce rôle d’élément d’un groupe, un héros de roman. En quoi le thérapeute constitue-t-il un personnage littéraire intéressant ? Il semble utile à quatre titres au moins. S’attacher aux pas d’un médecin permet au roman d’épouser le processus, ô combien dramatique et graduel, de la guérison. Le médecin se caractérise ensuite par sa capacité d’agir. Camus conclut par ces mots l’appel à l’engagement qui clôt La peste, s’adressant aux hommes « qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins ». Le médecin est un actant, un homme de pouvoir, celui à qui l’on confie son corps dans un geste de dépendance et de soumission. Il occupait ainsi dans les sociétés anciennes un rôle quasi magique, disposant d’un accès privilégié à un savoir habituellement refusé aux hommes.
En ce sens il apparaît aussi dans les textes littéraires comme un homme du secret, celui qui révèle et sait acccéder à l’intérieur. Le roman médical permet aussi un voyage aux frontières de la mort, enjeu littéraire par excellence. La médecine est enfin un thème riche car son histoire est faite de progrès et d’erreurs, et construit ainsi une passionnante chronique des hommes et des civilisations, de leurs maladies et de leurs morts.
« Cet air particulier de tristesse et de malédiction que l’on ne voit chez nous qu’aux hôpitaux et aux prisons. » (Tchékhov, Salle 6)
À l’opposé de cette figure idéalisée d’un médecin omnipotent, comme si les textes ne pouvaient représenter des médecins sans parti pris net, on rencontre une tradition tout aussi vivace. À cette sagesse extrême dont il est le dépositaire, correspond symétriquement l’extrême ignorance d’un médecin-savant, noyé dans les textes et les références aux maîtres de l’Antiquité, Hippocrate et Galien, perdant de vue le patient et son mal, sacrifiés à des méthodes inefficaces, lavements et saignées, voire, et c’est l’un des topoï de la satire des médecins, mortelles. Ce médecin est prétentieux et vénal, abuse de son autorité, exerce par la peur. Condamné par Montaigne (dans les Essais, au chapitre 37 du livre II : « En la médecine, j’honore bien ce glorieux nom, sa proposition, sa promesse si utile au genre humain, mais ce qu’il désigne entre nous, je ne l’honore ni ne l’estime ») ou Rousseau, (dans Émile : « Je ne dispute donc pas que la médecine ne soit utile à quelques hommes mais je dis qu’elle est funeste au genre humain. On me dira, comme on fait sans cesse, que les fautes sont du médecin, mais que la médecine en elle-même est infaillible. À la bonne heure, mais qu’elle vienne donc sans médecin »), il servira de cible à une satire virulente. Peu de professions concentreront des haines aussi vigoureuses. Ces médecins donneront naissance à une sorte d’emblème grotesque, du mire des fabliaux médiévaux, au Dottore de la Commedia dell’Arte, aux Diafoirus vêtus de noir des comédies et farces de Molière, et jusqu’au Knock de Jules Romains, pétris d’un savoir sclérosé, impuissants et dangereux. Le médicastre devient un type comique, avec ses attributs, ses préjugés, sa pseudo science, usurpateur et suffisant.
« Lorsque le médecin fait rire le malade, c’est le meilleur signe du monde. » (Molière, Le médecin malgré lui)
Mais là encore le théâtre place cette figure négative entièrement à son service. On connaît l’importance du corps dans le registre de la farce, et le médecin permet de faire entrer aisément la corporalité sur la scène. Et si le médecin s’épanouit au théâtre, c’est précisément parce que le médecin de comédie est représenté comme un être de dissimulation, de fausseté, s’arrogeant ses titres d’un coup de chapeau conique. Ce que Montesquieu fait observer en ces termes : « Un médecin ne le serait plus si ses habits étaient moins lugubres et s’il tuait ses malades en badinant. » Combien de Sganarelle, de Toinette déguisés en médecin sur la scène ? Si le médecin est un comédien, Molière ne peut-il pas à son tour se faire médecin ? L’art de la formule de ces médecines archaïques n’est-il pas fort semblable aux techniques de l’improvisation de la comédie italienne ? Comme une continuité de ce médecin en négatif, la littérature de science fiction prolongera le type avec le modèle du savant fou, qui tente d’outrepasser les possibilités de la science, qui du coup transgresse des interdits de l’ordre naturel : les docteurs Jekyll et Frankenstein, médecins qui détruisent plutôt qu’ils ne réparent.
« Écrire des ordonnances est facile, mais, au demeurant, se faire comprendre des gens, bien difficile. » (Kafka, Un médecin de campagne)
Il semblerait à première vue que l’on pourrait opposer une tradition romanesque favorable aux médecins à une tradition théâtrale qui leur serait hostile. Mais la littérature reflétant son temps, cette rupture se traduit aussi dans l’histoire des sciences.
Comme le fait remarquer le professeur Jean Bernard : « Il n’y a pas de grande différence entre le pouvoir, ou plutôt l’absence de pouvoir, d’un médecin du temps d’Hippocrate et le pouvoir, ou l’absence de pouvoir, d’un médecin du début de notre XIXe
siècle. » On observe un tournant, le passage de la médecine savante à la médecine expérimentale apparaissant lentement à partir du XVIIIe, une médecine qui se détache des textes, une médecine qui devient progressivement plus efficace, paradoxe d’une science antique mais tardivement opérante.
« Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur. » (Artaud, Le théâtre et son double)
Le lien entre le théâtre et la médecine, au-delà des identités établies plus haut, est renforcé par le rôle tout particulier que l’on assigne à l’art, celui de soigner. En effet, parce qu’elle raconte le dérèglement et la maladie, la littérature a été théorisée comme cure, comme purge. La catharsis aristotélicienne est de l’ordre du remède. Voir le mal sur la scène, permet au spectateur de se libérer de ses propres passions et pulsions. La littérature et l’art seraient donc comme une « médecine » de l’âme. D’autant que consommée à doses trop importantes ou mal assimilées, la littérature provoque elle-même des maladies. Elle contient à la fois le remède et le mal. La maladie qu’elle transmet le plus souvent, la folie, frappe ceux des lecteurs qui ne surent se prémunir contre ses dangers, Don Quichotte, Emma Bovary ou la balzacienne Dinah de la Baudraye.
Et écrire, loin de garantir l’auteur contre la folie, ne fait bien souvent qu’aggraver le mal, comme le montre Queneau dans son anthologie des fous littéraires français du XIXe siècle. De fait, la littérature construit un monde parallèle, propice à tous les épanchements, et le théâtre a ainsi été longtemps condamné… par les médecins eux-mêmes.
« Le docteur Katz entrait, tout de blanc vêtu, et venait me caresser les cheveux, je me sentais mieux et c’est pour ça qu’il y a la médecine. » (Ajar, La vie devant soi)
Si la littérature peut parfois avoir des vertus curatives, nombre d’écrivains ont adopté dans leurs textes, dans l’usage qu’ils y ont fait de la maladie, la position du médecin. La maladie occupe dans des romans comme des textes théoriques (Camus, Artaud, Ionesco), du fait de sa malléabilité et de son efficacité rhétorique, la place d’une métaphore de choix. Les cas d’écrivains-médecins au sens propre sont nombreux, citons parmi tant d’autres Rabelais, Céline ou Tchékhov, et le lien entre leurs deux « œuvres », s’il existe, mériterait d’être observé de près. Doit-on voir entre ces deux carrières une familiarité dans la sensibilité et la capacité d’écoute qu’elles exigent, une même quantité de science et culture, une identique volonté d’agir sur le monde et les hommes ? Et on ne peut qu’être frappé par les parallèles entre la langue des écrivains et celle des médecins, de la passion, à la mélancolie ou à l’empathie. Sans négliger dans les deux arts l’importance de la parole, du discours (la consultation), de l’écrit (la prescription), de la lecture (des signes du corps). Cette parenté entraîne sur le plan métaphorique celle du lecteur et du patient, c’est-à-dire celui qu’on cherche à toucher par le pathétique, celui qui éprouvera en lisant la compassion, et celui qui souffre dans sa chair. Mais ce statut d’écrivain-praticien pourrait aussi être attibué à des auteurs comme Zola, son système romanesque inspiré du médecin Claude Bernard, faisant de la littérature une science.
« C’est quand j’écris que je suis le plus vivant. » (Guibert, Le protocole compassionnel)
Pour achever cette enquête sur les liens entre médecine et littérature, il convient d’évoquer la question de l’autobiographie, en particulier du récit de maladie, comme en ont tenu Hervé Guibert ou William Styron, à l’enseigne de Montaigne. L’écrit permet, comme le malade le confirme au long de ses textes, à la fois une forme de libération de l’ordre de la confession mais tient aussi lieu de remède, de journal-soutien. Ces témoignages sont toujours émouvants parce qu’ils augmentent par leur charge physique leur puissance de réalité et l’analogie corporelle avec le lecteur. L’identification est d’autant plus forte que l’autobiographe souffre, qu’il révèle ce corps que nous avons en commun, bien qu’il dise l’irreprésentable, à savoir sa propre souffrance. Où l’on retrouve les liens étroits de la littérature et de la mort, tant dans ce cas précis la première conjure la seconde. Les récits de malades découvrent les limites de la médecine, la mort physique, alors qu’au contraire la littérature cherche et parfois atteint l’éternité.
« Puis soigneusement revisite les livres des médecins grecs, arabes, & latins, sans mépriser les Talmudistes & Cabalistes, & par fréquentes anatomies acquiers-toi parfaite connaissance de l’autre monde, qui est l’homme. » (Rabelais, Pantagruel)
Peut-on dire, pour conclure, que si la littérature et la médecine ont pour vocation commune d’apaiser la douleur, elles ont aussi toutes deux la douleur comme condition d’existence ? Rien n’est moins sûr : seules la littérature et la nécessité d’écrire paraissent vouées à disparaître une fois la douleur éteinte, une fois la mélancolie apaisée, comme si elles s’en nourrissaient, comme si finalement elles n’avaient, au contraire de la médecine, aucun intérêt à voir cesser ce mal qui leur permet d’être. L’écrivain serait, pour reprendre la formule de l’auteure d’origine indienne J. Lahiri, un « interprète des maladies » des hommes, qui sans les soigner, fait retentir leurs maux. Tchékhov écrit ainsi : « Et si l’on considère que le but de la médecine est de soulager la souffrance par des remèdes, on se pose malgré soi la question : pourquoi la soulager ? Premièrement, on dit que la souffrance conduit l’homme à la perfection, et, deuxièmement, si l’humanité apprend effectivement à soulager ses souffrances au moyen de pilules et de gouttes, elle rejettera complètement la religion et la philosophie où elle avait trouvé jusqu’alors non seulement une protection contre des maux de toutes sortes, mais même le bonheur. »