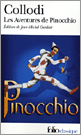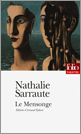Dossiers thématiques

Le mensonge
« Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois. » Corneille
À quoi bon le mensonge ? C’est autour de cette question que rayonnent les réflexions des philosophes et écrivains qui se sont intéressés à l’acte de mentir. Peut-on justifier le mensonge auquel nous avons, depuis l’enfance, tous recours? Est-il de bons mensonges, des mensonges nécessaires en certaines circonstances, de petits mensonges autorisés? D’un rejet absolu jusqu’à la fascination que peut exercer le menteur, les réponses apportées ont été diverses.
Et si le théâtre, lieu par excellence du masque et de l’illusion, a donné naissance à de nombreux port raits de menteurs, le roman d’imagination, dont le visage feint la réalité, a pu être vu en lui-même comme un innocent mensonge ou, pour reprendre le terme d’Aragon, un art du « mentir-vrai ».
Dossier réalisé par Dominik Manns, professeur de lettres, et initialement publié dans le numéro 27 des Mots du Cercle, février-mars 2006.
- Dossier
- Bibliographie
« À tant de menteries, comme il savait donner l’apparence du vrai ! » (Homére, Odyssée)
L’acte de mentir est d’abord une prise de parole, une formulation. Le mensonge par omission, parce qu’il est silencieux, n’en est pas vraiment un. Ce discours met en jeu une relation au minimum duelle. Le mensonge s’inscrit dans le cadre d’un dialogue, au cours duquel le menteur déformera volontairement une notion, une information que lui et son partenaire tiennent pour établie. Cette altération de la vérité répond à deux impératifs : le mensonge doit avoir l’apparence du vrai, sinon la tromperie ne prend pas (le menteur doit paraître de bonne foi), et le mensonge doit être formulé sciemment. Un mensonge involontaire n’en est plus un, il ressortit plutôt à l’erreur. On doit pouvoir identifier chez le menteur le désir de tromper, le désir d’ être cru.
Pour reprendre les mots de Rousseau dans la « Quatrième promenade » des Rêveries du promeneur solitaire, consacrée au mensonge : « Dire faux n’est mentir que par l’intention de tromper. » En ce sens, cette conscience forte du menteur qu’il est en train de jouer la comédie, c’est-à-dire qu’il connaît la vérité et choisit de la détourner, cette prise de risque assumée que représente le mensonge (que se passe-t-il si l’on me découvre ?) suppose une sorte de dédoublement. Quiconque ment a toujours un choix entre deux paroles : la vérité et le mensonge. Il prononce le mensonge tout en sachant parfaitement qu’il en est un. Et c’est donc à ce titre que le mensonge à soi-même relève du paradoxe. Comme le rappelle Jacques Derrida dans son Histoire du mensonge, la notion même de se tromper n’est pas sans poser des difficultés.
« Et, alors un mensonge m’a échappé, et mon nez s’est mis à grandir et il ne passait plus par la porte de la chambre. » (Collodi, Pinocchio)
Si la nature d’un mensonge fait qu’il est - dans un premier temps - nécessairement cru, c’est qu’il sait prendre parfaitement l’apparence de la vérité, et qu’en ce sens le mensonge est toujours d’abord invisible. Et c’est peut-être cette invisibilité qui en fait le caractère maléfique - comme la possibilité du mal absolu qu’offre au Wilhelm Storitz de Jules Verne le secret de l’invisibilité. Le visage impassible du menteur (Corneille écrit, à son propos : « Le dedans paraît mal en ces miroirs flatteurs »), le fait que le menteur semble dire la vérité, rend la tromperie redoutable. Rien, à part peut-être le nez de Pinocchio, ne permet de voir le mensonge. Et cette garantie dont l’insolent pantin prend malgré lui acte, le condamne à une vérité qui est tout sauf humaine. C’est bien là une qualité de l’homme, une de ses libertés, que de pouvoir mentir en toute liberté.
Et en même temps, le mensonge doit porter en lui-même l’amorce du dévoilement de sa véritable nature. En ce sens, un mensonge, dès qu’il est formulé, compte à rebours jusqu’au moment où la vérité va éclater. Un mensonge qui serait universellement cru n’en serait plus un, à moins de pouvoir pénétrer dans la conscience du menteur.
« Juliette. - Vous aimez ça ? Qu’on vous mente ? Mais c’est du vice… » (Sarraute, Le Mensonge)
L’histoire morale du mensonge coïncide avec celle de sa condamnation. Curieusement, il semble que ce soit toujours le point de vue de la victime malheureuse du mensonge qui ait été pris en compte. Et la plupart des auteurs, penseurs ou écrivains ont disqualifié le mensonge comme une des fautes les plus graves. L’Œnone de Racine précipite par son mensonge (elle défend Phèdre devant Thésée, accusant faussement Hippolyte de l’avoir séduite) la catastrophe de Phèdre. Car tout d’abord le mensonge pourrit la parole et la confiance qui y est attachée et par conséquent les liens entre les hommes. C’est ce que formule Montaigne : « En vérité le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole. » (Essais, Livre premier, « Des menteurs »). Quand il y a mensonge, «nous ne nous tenons plus, nous ne nous entreconnaissons plus.»
Géronte, le père du menteur "éponyme" de la pièce de Corneille, fait le même reproche à son fils, lui demandant : « Quel besoin avais-tu d’un si lâche artifice ? », brouillant de ses mensonges réitérés la confiance qu’il mettait en lui.
« Mais le revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini. » (Montaigne, Essais)
Mais c’est aussi parce que le menteur acquiert une forme de toutepuissance sur autrui qu’il convient de la limiter par la condamnation du mensonge. À ce titre, un roman comme L’ Adversaire d’Emmanuel Carrère, qui décrit la pyramide de mensonges élaborés par Jean-Claude Romand jusqu’au meurt re des siens, contient la condamnation implicite du mensonge, y compris du premier, du plus innocent, comme le fondement de tous les autres. Mais à travers sa personne, c’est aussi la notion même de parole que le menteur dégrade. Ne dit-on pas « donner sa parole » pour désigner un engagement absolu de bonne foi ? En ce sens une parole mensongère jette une ombre sur toutes les paroles à venir, car elle porte en elle la possibilité d’une nouvelle déception, elle anime à tout jamais le doute. Là encore, Cliton, le valet du menteur cornélien Dorante, dit à propos de la vérité : « Quand un menteur la dit, / En passant par sa bouche elle perd son crédit. » Une fois démasqué le menteur se voit atteint par la permanence du mensonge, et la reconquête de la confiance paraît impossible.
« Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois. » (Corneille, Le Menteur)
Si l’on interroge l’acte même de mentir, le dédoublement de conscience qu’il nécessite, on réalise que tout mensonge est en fait une dissimulation. Les menteurs se servent de cette possibilité qu’offre le langage pour faire disparaître - mais du même coup apparaître - de la vue d’ autrui une vérité blessante ou importune.
Une vérité qu’en tout cas, pour mille et une raisons, le menteur souhaite garder pour lui. Et c’est bien là aussi le risque que prennent,
à l’image du Rousseau des Confessions, les auteurs d’autobiographies : pourfendre le mensonge c’est s’exposer, c’est trahir douloureusement son amour-propre au nom de la vérité qu’impose la sincérité. Le menteur préfère lui partager un mensonge plutôt que ce secret qu’il voile. En ce sens, mensonge et secret entretiennent un lien de parenté certain, tous deux envers de l’aveu. Ainsi le Dorante de la Suite du Menteur, condamné à la prison à tort, décide-t-il de mentir pour cacher l’identité du coupable véritable en qui il a reconnu un gentilhomme. À l’inverse, les menteurs compulsifs, comme le colonel Capadose du Menteur d’ Henry James, semblent ne rien dissimuler sous leurs affabulations, et le secret devient énigme.
« O l’utile secret de mentir à propos ! » (Corneille, Le Menteur)
Les textes littéraires qui font d’un menteur le centre de leur intérêt ont à son endroit une attitude pour le moins ambiguë. Le menteur, bien que condamnable parce que trompeur, est aussi un triomphateur. Il remporte sur les autres, sur leurs crédulités, une victoire éclatante - bien que provisoire - jouissant de son pouvoir absolu de manipulation de l’autre. Dorante en ce sens exerce son éloquence sur ses amis, inventant un spectacle aquatique des plus démesurés, qui convainc malgré tout ses auditeurs. Au menteur tout est permis. Mais il emporte également une victoire sur le réel, camouflant les faits de ses paroles, arrangeant un monde menaçant qui ne lui convient pas. Le menteur domine donc aussi l’ingrate réalité, transformant un danger en bienfait. Au-delà de la condamnation de principe, ne doit-on pas rappeler que le mensonge est pour celui qui le formule, mais également pour celui (lecteur, spectateur) qui y assiste sans le subir, un moment de plaisir ? Cert e s le menteur est généralement dénoncé par l’écrivain (Tartuffe est clairement désigné comme l’ennemi et Corneille donne à son Menteur trop sulfureux une Suite dans laquelle Dorante ment pour autrui et pour faire le bien), mais le mensonge demeure bien souvent une subtile création difficilement méprisable.
« Mentir sans profit ni préjudice de soi ou d’autrui n’est pas mentir : ce n’est pas mensonge, c’est fiction. » (Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire)
Il y a bien en effet un lien étroit entre le mensonge et l’invention créatrice. Les synonymes du mensonge (« conte », « comédie », « fable ») rappellent que le bon menteur est aussi un auteur virtuose. Sans talent, point de mensonge, ce que rappelle Platon lorsqu’il compare deux héros homériques. Ulysse le menteur n’est-il pas supérieur à Achille dans la mesure où il sait user du vrai et du faux et que ses mensonges (on pense notamment à ses ruses chez le Cyclope) sont autant de prouesses, révélant son ingéniosité, son courage et son héroïsme ? « Il faut bonne mémoire après qu’on a menti », indique Cliton, son maître renchérit : « Le Ciel fait cette grâce à fort peu de personnes, / Il y faut promptitude, esprit, mémoire, soins. » Et si le personnage du Menteur de James apparaît comme un imposteur, il est aussi un homme séduisant, suscitant autour de lui admirations mondaines. Il y a sans doute entre auteurs de fictions et menteurs une connivence que souligne Gilles Barbedette dans son Invitation au mensonge : les auteurs qui le fascinent (Flaubert, Sterne, Proust) sont ceux qui, s’éloignant d’une représentation vériste, documentaire ou sincère du réel (telle qu’ont pu la prôner les auteurs naturalistes ou plus récemment les autobiographes), choisissent les voies de la fantaisie. Pour lui, « le roman est la chance morale du mensonge ».
« - Alors, tout ce qu’il m’a raconté hier soir, je suppose, n’était que mensonges. » (Henry James, Le Menteur)
La fiction comme mensonge sans volonté de nuire, puisque son seul souci serait de dive rtir du monde réel, trouve - comme le rappellent les mots du mensonge : feinte, fourbe, comédie - dans le dispositif spectaculaire du théâtre une forme d’expression particulièrement efficace. Le dédoublement mensonger épouse parfaitement le principe de la double énonciation théâtrale. Le spectateur est toujours ave rti du mensonge professé sur la scène, et c’est le recoupement qui trahit le menteur. C’est peut-être pour cette raison que Molière a écrit bon nombre de rôles de menteurs et d’hypocrites.
Le public est alors à la fois complice et juge du mensonge en train de se faire. Et le personnage d’Alceste, dénonçant de manière absolue le mensonge social et la flatterie (« Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur, / On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur »), apparaît comme une sorte de chimère à la fois effrayante (si on le suivait, il n’y aurait plus ni fiction, ni théâtre, ni société humaine, et c’est sans doute là une explication métaphorique à sa sortie finale de la scène) et pourtant indispensable (car il met l’hypocrisie à nu, et se fait détenteur de la moralité théâtrale). Le mensonge se tient entre ces deux pôles : un danger nécessaire.